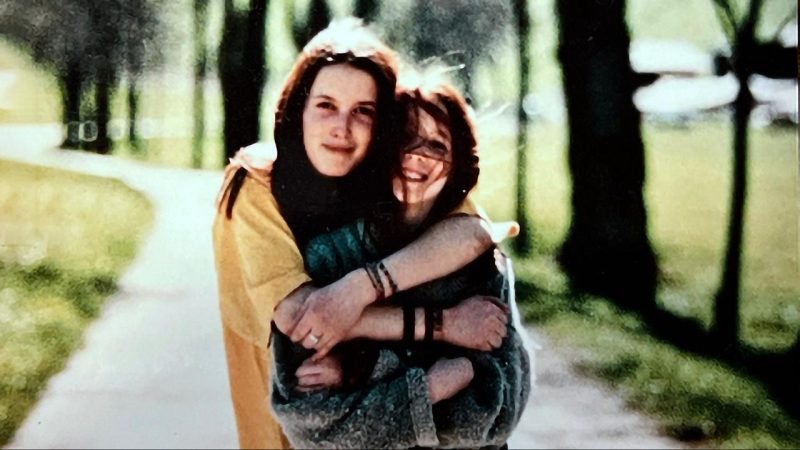Blösch au Schauspielhaus Zürich : une adaptation scénique du roman bernois de Beat Sterchi et une réception contrastée
Origine et source littéraire
La pièce intitulée Blösch s’inspire du roman de Beat Sterchi, écrivain originaire du canton de Berne. Dans les éditions Zoé, l’œuvre est publiée sous le titre La vache, et elle est présentée comme une étude approfondie des mécanismes du travail agricole et des rapports entre humains et animaux, dans une perspective documentaire et littéraire.
Le roman, publié vers 1983, est souvent décrit comme une œuvre brute et précise, où les odeurs et les sensations liées à l’élevage et à l’abattoir occupent une place centrale. Le récit demeure étroitement associé au canton de Berne et est fréquemment présenté comme une des analyses les plus sèches de la réalité suisse contemporaine. La transposition théâtrale cherche à préserver cette tonalité tout en proposant une mise en scène spécifique à la scène zurichoise.
Transposition scénique au Schauspielhaus Zurich
Le metteur en scène Rafael Sanchez, né à Bâle et co-directeur du Schauspielhaus, opte pour une relecture qui mêle atmosphere rurale et éléments d’opérette locale. L’interprétation de Blösch est assurée par Mirjam Rast, qui mêle chant et voix parlées, avec des passages chantés en français. L’abattoir, élément clé du récit, est suggéré par un dispositif scénique symbolique plutôt que montré de manière frontale.
Dans le cadre narratif, Ambrosio—fils de boucher originaire d’Espagne—est engagé comme valet de ferme chez les Knuchel et voit sa trajectoire se mêler à celle du métier d’abatteur. Parallèlement, Blösch passe d’un statut honoré de vache laitière à une réalité de bête vouée à l’équarrissage, ce qui met en lumière les tensions entre valeur économique et dignité animale.
Langue, accessibilité et choix dialectaux
Le roman est initialement rédigé en allemand et sa traduction théâtrale est proposée en bernois par Mike Muller, figure notable de la scène suisse alémanique. Toutefois, le spectacle ne comporte pas de surtitrage, ce qui peut limiter l’accès pour les spectateurs non germanophones, notamment romands et étrangers. L’emploi du dialecte bernois et les références culturelles locales contribuent à un effet d’immersion pour le public régional, mais risquent d’en restreindre l’assistance au-delà de l’audience habituelle du théâtre zurichois.
Contexte et réception
La démarche vise à rester fidèle à l’esprit de l’œuvre, qui interroge les conditions de travail dans les abattoirs, le statut des animaux et, dans une certaine mesure, des questions de discrimination à la suite d’initiatives xenophobes de l’époque décrite dans le récit. Sur scène, l’univers rural est évoqué par un décor et des costumes traditionnels, et l’ouverture est marquée par un trio de musique folklorique qui ancre l’esthétique locale.
La production s’inscrit dans un contexte institutionnel zurichois marqué par des discussions autour de l’orientation du théâtre public et du rôle de l’art dans les enjeux socioculturels. Le départ du précédent directeur en 2024, au milieu de polémiques autour du wokisme et des réactions de certains abonnés, a influé sur les choix esthétiques et sur la tonalité générale de la programmation. Le nouveau souffle visuel et musical du spectacle a été perçu, par certains, comme une réponse à ce contexte.
Conclusion et programmation
Lors de sa première, la réception a été mitigée et une note de 2 sur 5 a été attribuée par un critique. Le spectacle est programmé au Schauspielhaus Zürich jusqu’au 3 décembre 2025, offrant une lecture contemporaine d’un roman marquant du paysage berlinois et bernois tout en posant la question des limites d’une adaptation théâtrale d’une œuvre dense.